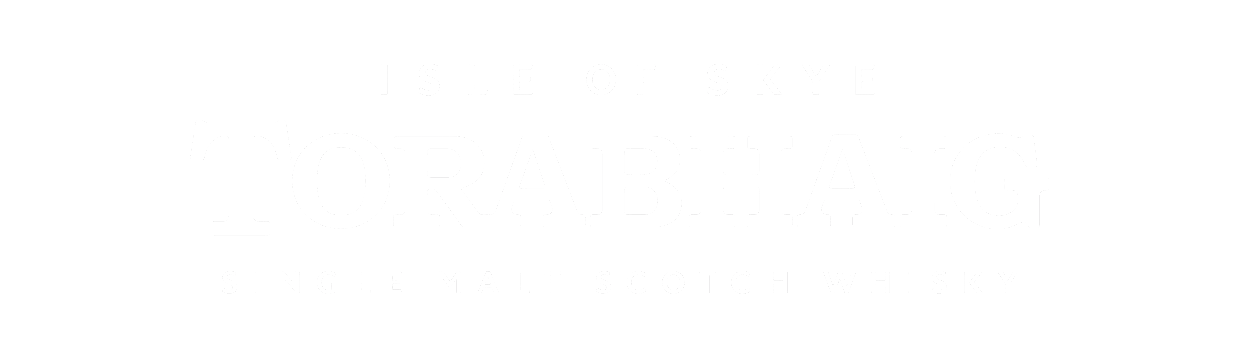Le Dr Mike Billett, membre du Torabhaig Club et passionné de tourbe, revient en tant qu'auteur invité - cette fois avec une plongée plus profonde dans l'un des éléments les plus mystérieux du whisky tourbé : les phénols.
Dans ce nouvel article, Mike décrypte la science derrière la fumée : de la formation des phénols pendant le touraillage à la raison pour laquelle un même PPM peut varier considérablement d'un verre à l'autre. C'est un regard fascinant sur les composés aromatiques qui confèrent au whisky tourbé son caractère, et sur la subtile alchimie qui sous-tend la fumée savoureuse.
Alors, si vous vous êtes déjà demandé ce qui fait vraiment chanter un whisky fumé, celui-ci est pour vous.
-
Quand on parle de whisky fumé, la conversation s'oriente rapidement vers les phénols. Quel est le degré de tourbage : léger, moyen, intense, voire même très intense ? Pourquoi des whiskies tourbés au même degré ont-ils un goût différent ? « Malté à un niveau ahurissant de 152,7 ppm » : qu'est-ce que cela signifie ? Il est temps d'approfondir la question, d'ouvrir la « boîte noire », d'explorer comment nous mesurons les phénols et ce qui se passe lors de la fabrication du whisky.
La combustion de la tourbe dans un four produit une série de produits de combustion qui s'élèvent avec énergie vers l'orge en cours de séchage : eau, dioxyde de carbone, furfural (un composé à l'arôme d'amande et de biscuit sucré), divers hydrocarbures non phénoliques et les phénols essentiels. Ces trois derniers sont tous des congénères, les éléments aromatiques du whisky. Certains adhèrent au grain, d'autres non. Les phénols produits par la chaleur, qui fracturent leurs grands précurseurs polyphénoliques, sont petits, légers et volatils, facilement absorbés par les enveloppes d'orge, conférant au malt cet arôme et cette saveur fumés. Augmentez la température, augmentez le débit d'air, utilisez de la tourbe humide plutôt que sèche. Modifiez les conditions à l'intérieur du four et vous modifierez les saveurs du malt en cours de séchage, car la chimie de la combustion opère son alchimie.
Les composés phénoliques sont omniprésents, fabriqués naturellement par les plantes et les micro-organismes. Ils ont été identifiés chimiquement à la fin du XVIIIe siècle et isolés pour la première fois en 1834 à partir de goudron de houille. Ils ont rapidement trouvé une utilisation qui perdure encore aujourd'hui, comme antiseptiques, désinfectants, conservateurs efficaces et, plus récemment, comme arômes. Le plus basique est un composé appelé phénol, dont la formule chimique est C6H5OH : un cycle d'atomes de carbone sur lequel est fixé un groupe hydroxyle (-OH). De manière quelque peu confuse, le nom « phénol » peut être utilisé soit pour ce composé spécifique, soit comme terme générique pour décrire le groupe plus large de composés organiques auquel il appartient.
Un panel sensoriel est formé à l'odorat et à l'identification des membres individuels du groupe des phénols, les trois « familles phénoliques ». Les crésols – puissants antiseptiques et médicinaux ; les phénols – versions plus douces et sucrées de la trousse de premiers soins ; les gaïacols – un groupe plus énigmatique, dont les épices, les herbes et les parfums se mêlent aux pansements. Les crésols et les gaïacols possèdent un groupe fonctionnel méthyle (-CH3) ou méthoxy (-OCH3) supplémentaire, fixé au cycle carboné de base. Ce groupe peut se positionner n'importe où et, fait remarquable, ces petites différences structurelles influencent profondément l'odorat des panélistes. Chaque composé a un point d'ébullition différent et, bien que les phénols en tant que groupe se détachent plus tard dans le processus de distillation, un distillateur peut les « couper » à différents moments pour capturer les saveurs souhaitées et créer des différences importantes dans la nature du nouveau spiritueux. La chimie et la physique du touraillage et de la distillation déterminent les arômes et les goûts du spiritueux tourbé.
En 1968, un chimiste travaillant pour un malteur anglais publia un article scientifique qui transforma la fabrication du malt tourbé en fournissant un moyen de mesurer sa teneur phénolique globale en ppm (parties par million). Cette méthode, baptisée « méthode Macfarlane », du nom de son fondateur, impliquait l'extraction et l'oxydation des phénols avant leur complexation avec un colorant. Plus la couleur était intense, plus la concentration en phénols était élevée. Au fil du temps, cette méthode colorimétrique simple fut modifiée et devint rapidement la norme industrielle pour la mesure des « phénols totaux » dans le malt tourbé.
Des méthodes comme la chromatographie permettent d'ouvrir la « boîte noire » du phénol et d'en révéler le contenu. Elles exploitent les différences de structure chimique qui affectent la solubilité et la volatilité, chaque composé apparaissant sous la forme d'un pic individuel sur un graphique. Plus le pic est élevé, plus la concentration est élevée. En résumé, les composés phénoliques se comportent tous légèrement différemment, et ces différences sont exploitées par la chromatographie liquide haute pression (CLHP), l'instrument de référence de l'industrie. Comme cette méthode identifie la totalité ou la plupart des phénols volatils importants, elle offre une précision accrue et une valeur globale de phénol total plus élevée.
Il est intéressant de noter que les deux méthodes cohabitent dans un laboratoire de whisky moderne, sans norme unique convenue. La teneur en phénol est désormais un élément de chimie essentiel pour le buveur de whisky, mais il est également important de reconnaître que, dans la commercialisation du whisky tourbé, la concentration en ppm de phénols de l'orge maltée est utilisée presque exclusivement, et non la concentration finale du spiritueux. Torabhaig fait partie des rares exceptions, mentionnant à la fois les phénols présents dans le grain (orge maltée) et les phénols résiduels (alcool distillé), ces derniers étant nettement inférieurs à la valeur initiale. L'ajout d'eau pendant l'élaboration du whisky, le retrait des enveloppes fumées à la pression après le brassage, l'adhérence des phénols aux tuyaux et aux récipients, et les pertes pendant la distillation contribuent tous à la baisse de la concentration en phénols. La maturation atténue également les arômes fumés, mais les experts m'indiquent que cela est davantage dû à l'influence croissante d'autres congénères produits par le bois qu'à une baisse de la concentration en phénols. En passant plus de temps en fût, le single malt tourbé Torabhaig deviendra-t-il encore plus tempéré ?
Pour profiter des réflexions précédentes du Dr Mike Billet sur le monde de la tourbe, cliquez ici .